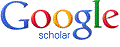Hémoglobine A1C : quoi de neuf ?
Auteurs : Gillery P1La découverte de l'hémoglobine A1c (HbA1c) remonte à la fin des années 1960, quand on a montré que l'hétérogénéité chromatographique de l'hémoglobine humaine était due à la fixation post-traductionnelle de résidus glucidiques. La fraction prépondérante de ces formes d'hémoglobine modifiées (glyquées), caractérisée par la fixation de glucose à l'extrémité N-terminale des chaînes b de la globine, a été identifiée et appelée HbA1c en raison de son comportement en chromatographie. L'intérêt pour ce paramètre s'est renforcé quand on a montré que cette forme d'hémoglobine était augmentée dans le sang des diabétiques, et l'hypothèse qu'un dosage d'HbA1c pouvait constituer un marqueur de l'équilibre glycémique a été vérifiée [1, 2]. On a donc disposé, au cours des années 1970, de ce nouveau marqueur, structuralement bien défini, reflet cumulatif et rétrospectif de l'équilibre glycémique des 4 à 6 semaines qui précèdent le dosage. Les études cliniques, dont celle du Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) aux États-Unis, ont montré l'intérêt de ce test dans le suivi à long terme, aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2. Notamment, une corrélation entre l'équilibre glycémique évalué par l'HbA1c et l'apparition de complications dégénératives a été établie [3-5]. Le processus d'introduction du dosage d'HbA1c en pratique médicale aurait donc dû être évident. En pratique, des obstacles majeurs sont apparus.