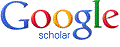Physiopathologie de l'obésité. Facteurs nutritionnels et régulation de la balance énergétique.
Auteurs : Ziegler O1, Quilliot D, Guerci BLe développement de l'obésité suppose une régulation anormale de la balance énergétique et/ou de celle des macronutriments. Lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses, l'excès des calories est stocké sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Les lipides ont un rôle clef par rapport aux glucides ou aux protéines car leur densité énergétique élevée et leur palatabilité sont associées à un effet satiétogène relativement faible. De plus l'oxydation de ces nutriments n'augmente pas quand les apports sont plus importants que les besoins. Le comportement alimentaire n'a pas seulement une signification nutritionnelle. Il est influencé par de multiples facteurs d'ordre psychologique ou socioculturel. Le rôle de la fréquence des prises alimentaires et leur distribution est l'objet de débats, comme l'est aussi la responsabilité éventuelle des troubles du comportement alimentaire. Sont-ils la cause ou la conséquence de l'obésité ? La restriction alimentaire cognitive est par exemple une cause fréquente de dysrégulation des mécanismes physiologiques de la faim et de la satiété, conduisant à la perte de contrôle. Cet échappement est à l'origine de prises alimentaires impulsives et d'échec thérapeutique. L'augmentation de la masse grasse est d'abord le fait d'une augmentation de la taille des adipocytes (hypertrophie). Puis le nombre de cellules augmente (hyperplasie). Mais des facteurs adipogéniques de nature hormonale ou métabolique sont susceptibles d'induire la différenciation des préadipocytes, en particulier à certaines périodes de la vie, qualifiées de phases critiques. Les acides gras polyinsaturés et les protéines pourraient jouer un rôle à ce niveau. Il a été montré en particulier que la précocité de l'âge du rebond d'adiposité, qui est un facteur de risque d'obésité ultérieure, était significativement associée à la consommation de protéines à l'âge de 2 ans. Ces facteurs pourraient donc exercer leur influence au début de la vie, voire même in utero. Il serait important d'entreprendre de nouvelles études longitudinales pour mieux comprendre par exemple le rôle des macronutriments, le déterminisme des choix alimentaires ou la responsabilité des troubles du comportement alimentaire chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.