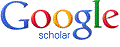Hypothèse glutamatergique de la schizophrénie: apports des recherches cliniques sur la kétamine.
Auteurs : Mechri A1, Saoud M, Khiari G, d'Amato T, Dalery J, Gaha LL'implication du système glutamatergique dans l'étiopathogénie de la schizophrénie a été renforcée ces dernières années par les recherches cliniques sur la kétamine, antagoniste non compétitif des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) utilisé comme anesthésique. Il ressort de ces études que la kétamine à des doses sub-anesthésiques peut provoquer, chez des sujets sains, des perturbations cognitives et des symptômes positifs et négatifs rappelant les psychoses schizophréniques. Chez des patients schizophrènes, la kétamine peut induire une exacerbation des symptômes psychotiques, présentant une grande similitude avec les symptômes présentés lors des épisodes aigus. Ces effets de la kétamine sont transitoires, réversibles et variables en fonction du temps, de la dose et des conditions d'administration. La susceptibilité aux effets de la kétamine est âge-dépendante. Elle se manifeste à partir de l'adolescence et atteint son maximum chez l'adulte jeune. Les études portant sur la capacité de certains psychotropes à bloquer les effets de la kétamine ont montré la supériorité des antipsychotiques atypiques et en particulier de la clozapine. Les effets de la kétamine s'expliquent à la fois par le blocage des récepteurs NMDA, mais aussi par des perturbations de la transmission dopaminergique corticale et sous-corticale. Ainsi, ces recherches ont l'opportunité d'offrir un modèle expérimental des psychoses schizophréniques permettant de mieux comprendre les mécanismes sous-tendant la décompensation psychotique, voire de développer, à terme, de nouveaux agents antipsychotiques.