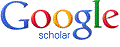Exploration biologique de la protéinurie au laboratoire d’analyses : aspects quantitatifs
Auteurs : Le Bricon T1L'analyse de la protéinurie fait partie des examens urinaires les plus demandés au laboratoire. Une protéinurie supérieure à 150 mg/L est souvent découverte de manière fortuite en médecine préventive ou scolaire (bandelettes) ou au laboratoire (dosage). Son exploration complète, hiérarchisée (quantitative, puis qualitative) et répétée présente un intérêt majeur pour le clinicien pour affirmer le diagnostic d'une protéinurie pathologique et pour effectuer le suivi thérapeutique d'une néphropathie, d'une uropathie ou d'une maladie générale (diabète sucré, myélome multiple). Les formes les plus fréquentes (90 % des cas) et sérieuses de protéinurie sont glomérulaires, associées au syndrome néphrotique, à l'hypertension artérielle et à l'insuffisance rénale progressive. Le biologiste apportera un soin particulier à l'étape pré-analytique (recueil, traitement, conservation), aux données cliniques et aux prescriptions éventuelles de médicaments pouvant interférer avec le dosage. Depuis une dizaine d'années, des avancées significatives ont été réalisées sur le plan analytique: abandon au laboratoire des méthodes de dépistage utilisant la bandelette (faux positifs et surtout faux négatifs), abandon des techniques manuelles de dosage par précipitation avec détection turbidimétrique (coefficients de variation interlaboratoires trop élevés), remplacement du bleu de Coomassie par le rouge de pyrogallol (meilleure praticabilité). Le contrôle de qualité urinaire a objectivé ces améliorations avec une réduction considérable des coefficients de variation interlaboratoires. Il n'existe cependant toujours pas de méthode de référence de dosage des protéines urinaires totales et les limites des dosages utilisant les réactifs au rouge de pyrogallol doivent être impérativement connues: composition très variable des réactifs selon les fabricants (présence d'additifs comme le sodium dodécyl sulfate, par exemple), sensibilité limitée, choix difficile du calibrant, sous-estimation des chaînes légères, et enfin interférence avec les solutés de remplissage vasculaire à base de gélatine.