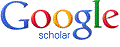Du caryotype « monocouleur » au caryotype « multicouleur » : applications de la M-Fish en hématologie et en oncologie
Auteurs : Jaffray JY1, Giollant M, Perissel B, Vago PDepuis l'établissement du premier caryotype humain en 1956, la cytogénétique médicale a progressé très rapidement. Dès 1960, la première observation du chromosome de Philadelphie ouvrait une nouvelle voie: celle de la cytogénétique hématologique et oncologique. Mais la technique originale, ne permettant qu'une coloration uniforme de l'ensemble des chromosomes, limitait la caractérisation de la plupart des remaniements de structure. Différentes recherches, tendant à la fois à mieux connaître la structure des chromosomes, à expliquer le mécanisme des remaniements et à mieux identifier les chromosomes, se développèrent: autoradiographie, techniques de bandes, microscopie électronique… Depuis 1980, une nouvelle évolution fait progresser la cytogénétique: alliant des techniques de cytogénétique classique et des techniques de biologie moléculaire, plusieurs chercheurs ont mis au point le marquage in situ, sur chromosome métaphasique et noyau interphasique, du génome par des sondes non radioactives. La Fish (fluorescence in situ par hybridation) est née. Elle permet de caractériser de nombreuses anomalies de nombre et/ou de structure, mais elle présente des limites, en particulier celle d'être une approche ciblée nécessitant une identification préalable de l'anomalie à rechercher. Le caryotype multicouleur (M-Fish ou Sky), dernière évolution de la Fish sur métaphase, permet de pallier cette limite, à condition de disposer de métaphases. Comme le montre les trois exemples présentés, la M-Fish permet l'identification précise de remaniements aussi complexes que ceux rencontrés en hématologie et en oncologie. Enfin, si on ne dispose pas de métaphases, il peut être fait appel à l'hybridation génomique comparative (CGH) pour détecter et, simultanément, localiser sur les chromosomes des pertes ou des gains en ADN génomique.