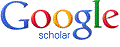Dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Auteurs : Soubrane G1, Haddad WM, Coscas GDonnées épidémiologiques et pathogéniques La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est la première cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 55 ans dans les pays industrialisés. Sa prévalence augmente avec l'âge, atteignant jusqu'à un quart de la population âgée de plus de 75 ans. La pathogénie de cette affection demeure mal connue. En plus du vieillissement, d'autres facteurs à la fois génétiques et environnementaux sont impliqués à divers degrés. Aspects cliniques Des précurseurs (premiers signes cliniques de DMLA) peuvent être observés à l'examen du fond d'oeil : drusen (dépôts localisés de lipides et de lipoprotéines) et altérations de l'épithélium pigmentaire (EP) rétinien (hypo- ou hyperpigmentations). Les complications de la maladie révèlent 2 formes : atrophique (ou sèche) et exsudative (ou humide). La forme atrophique est définie par la présence d'une dégénérescence centrale de l'EP, de la choriocapillaire et des photorécepteurs, résultant de l'élargissement et/ou de la coalescence de petites aires d'atrophie périfovéolaire (atrophie dite géographique). La forme exsudative, responsable de la grande majorité des cas de malvoyance dus à la DMLA, se caractérise par l'apparition de néovaisseaux choroïdiens, identifiables grâce à l'angiographie à la fluorescéine et responsables de décollements séreux rétiniens, d'oedèmes et d'hémorragies aboutissant à la destruction des photorécepteurs maculaires. Au point de vue thérapeutique Le traitement de la forme atrophique est actuellement uniquement palliatif (aides visuelles et rééducation de la basse vision). Les traitements de la forme exsudative ayant démontré leur efficacité sont la photocoagulation laser et la photothérapie dynamique avec la verteporfine, permettant une stabilisation relative de l'acuité visuelle pour environ 2/3 des yeux. D'autres traitements sont actuellement en cours d'évaluation : thérapeutiques antiangiogéniques, techniques chirurgicales (exérèse des néovaisseaux, translocation fovéolaire), nouveaux traitements laser (thermothérapie transpupillaire, photocoagulation sélective des vaisseaux nourriciers). Transplantations de photorécepteurs et de l'épithélium pigmentaire ou implantation de microphotodiodes représentent d'autres alternatives à plus long terme.