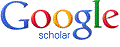Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
Auteurs : Bruneel F1, Gachot B, Wolff M, Bedos JP, Regnier B, Danis M, Vachon FDéfinition La fièvre bilieuse hémoglobinurique est une entité clinique caractérisée par une hémolyse intra-vasculaire aiguë survenant classiquement après la reprise de quinine par un sujet résidant de longue date en zone d'endémie à Plasmodium falciparum, et prenant itérativement ce médicament. Cliniquement La symptomatologie apparaît brutalement avec émission d'urines de couleur porto, ictère, pâleur, nausées, fièvre et insuffisance rénale aiguë. L'anémie aiguë de type hémolytique est d'emblée profonde. La parasitémie est faible ou nulle. Le mécanisme de l'insuffisance rénale est une nécrose tubulaire. Quinine et molécules proches Bien connue au début du XXe siècle, la fièvre bilieuse hémoglobinurique est devenue exceptionnelle depuis 1950, après le remplacement de la quinine par la chloroquine. Cette maladie est réapparue vers 1990, succédant à la réutilisation de la quinine du fait de la chloroquinorésistance. Puis, plusieurs cas ont été décrits avec l'halofantrine et la méfloquine, deux nouvelles molécules proches de la quinine (famille des amino-alcools). La physiopathogénie est mal connue mais il semble cependant que la conjonction d'une double sensibilisation des hématies à P. falciparum et aux amino-alcools soit indispensable au déclenchement de l'hémolyse. Évolution La gravité du tableau impose souvent une prise en charge initiale en réanimation. Mais de nos jours, le pronostic est bon, avec le plus souvent, une guérison sans séquelle.