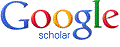Physiopathologie des syndromes coronariens aigus.
Auteurs : Quilici J1, Gallo RL'athérosclérose coronaire et ses complications thrombotiques représentent l'une des principales causes de mortalité et de morbidité en Europe. Dans les sociétés occidentales, on observe un développement précoce des lésions athéromateuses, la présence de plaques asymptomatiques pouvant être constatée dès la fin de la deuxième décennie. L'évolution de ces lésions se fait habituellement par poussées successives, de façon silencieuse ou sous forme de syndrome coronarien aigu comme un angor instable, un infarctus sans onde Q, un infarctus transmural ou une mort subite. Ce mode de progression n'exclut pas des phases de régression, ou plus fréquemment de stabilisation des plaques, qui sont alors en fonction de leur retentissement hémodynamique à l'origine de tableaux d'ischémie myocardique chronique. Les syndromes coronariens aigus (SCA) correspondent à un même processus physiopathologique ; la rupture d'une plaque athéromateuse initiant des phénomènes thrombotiques, inflammatoires et vasomoteurs délétères. Ce concept n'est pas nouveau, mais les progrès accomplis ces dernières années laissent penser que la composition et la biologie de la plaque sont des facteurs intervenant plus dans l'initiation des SCA, que la taille de celle-ci. Il apparaît clairement que les lésions « molles », riches en lipides, sont non seulement les plus instables, mais aussi les plus thrombogéniques en raison de leur richesse en facteur tissulaire. Après avoir détaillé la structure des plaques vulnérables, nous évoquerons les causes de leur rupture et la cascade d'événements qui en découle, responsable de tableaux cliniques mettant en jeu le pronostic vital.