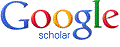Maladie d'Alzheimer: hypothèses impliquant les apolipoprotéines E.
Auteurs : Blain H1, Merched A, Visvikis S, O'Kane M, Pillot T, Siest G, Jeandel CLa grande star actuelle de la recherche sur la démence sénile de type Alzheimer (DSTA) est, sans aucun doute, l'apolipoprotéine E (apoE). Le locus de l'apoE situé sur le chromosome 19 (19q12) possède trois allèles majeurs ε2, ε3, ε4 qui composent 6 génotypes et 6 phénotypes protéiques. L'apoE est bien connue pour ses propriétés de transporteur du cholestérol de cellule à cellule et d'organe à organe. La découverte récente de la fréquence élevée de l'allèle ε4 chez les patients atteints de DSTA, la liaison entre DSTA et le gène de l'apoE sur le bras long du chromosome 19 ainsi que la présence de l'apoE aux côtés de la protéine bêta amyloïde (Aβ) dans les plaques séniles, les dégénérescences neuro-fibrillaires (DNF) et les vaisseaux des sujets atteints de DSTA sont autant d'arguments en faveur du rôle de l'apoE dans la physiopathologie de la maladie. Différentes hypothèses ont été avancées ; certaines impliquent l'action différentielle des isoformes sur la croissance et la réparation neuronale, sur la formation de complexes avec Aβ ou sur la clairance de Aβ. L'apoE serait ainsi, pour certains, une chaperone pathologique, pour d'autres, elle protégerait le neurone d'Aβ. Une autre hypothèse met en jeu l'interaction entre l'apoE et la protéine tau, constituant principal des DNF, sous forme hyperphosphorylée. L'apoE3, contrairement à l'apoE4, pourrait séquestrer la protéine tau, empêcher sa phosphorylation et lui permettre de conserver son action de stabilisateur des microtubules neuronaux. Quoi qu'il en soit, la détermination du génotype de l'apoE ne peut, en aucune façon, permettre à elle seule le diagnostic de la maladie. L'allèle ε4 constitue un facteur de risque indéniable mais sa présence n'est ni nécessaire, ni suffisante au développement de la DSTA. De nombreux autres facteurs ont probablement eux aussi un rôle modulateur.