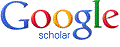Immunologie du paludisme humain à Plasmodium falciparum.
Auteurs : Vanham G1, Bisalinkumi E(Cet aperçu est destiné aussi aux cliniciens sans formation spécifique en immunologie). Les différents stades de Plasmodium falciparum (les sporozoïtes, les stades sanguins asexués et les gamétocytes) interagissent de façon particulière avec le système immunitaire humain. L'immunité spécifique envers les stades hépatiques ne peut être réalisée que par une action coordonnée des cellules CD8 T et des anticorps spécifiques, qui collaborent avec les cellules natural killer (NK) et les macrophages (MA). L'interféron-gamma (IFN-γ) γ joue un rôle important. Une immunité non spécifique et concomitante envers les sporozoites est basée sur une réaction de cytokines, induite par les stades sanguins. Ni l'immunité spécifique, ni les réactions non spécifiques ne peuvent assurer une protection contre des infections répétitives, entre autre à cause de la variation antigénique des structures de surface des sporozoites. Les macrophages de la rate sont essentiels dans la défense contre les mérozoites et les globules rouges (GR) parasités. L'élimination des parasites est facilitée par des anticorps spécifiques, produits sous la direction des cellules CD4 T. Il y a cependant de multiples mécanismes d'immunodéviation, de suppression et d'adaptation évolutionniste, qui empêchent le développement d'une immunité stérilisante après infection. L'absence de symptômes en présence de parasites, est néanmoins souvent observée chez les individus en zone endémique. Si le contact avec les parasites est interrompu, cette immunité clinique ne persiste pas longtemps. Une observation curieuse mais confirmée est l'absence d'une influence négative du SIDA sur les accès palustres. Toutes ces données indiquent qu'une mémoire immunitaire solide, basée sur les cellules T, n'est pas évidente dans le paludisme humain. La malaria cérébrale et certaines autres complications graves sont la conséquence de l'élimination insuffisante par la rate des érythrocytes parasités, en combinaison avec des facteurs du parasite (certaines variantes des antigènes de surface) et la génétique de l'hôte (complexe majeur d'histocompatibilité, groupe sanguin etc.). Les GR parasités se fixent sur l'endothélium de la microcirculation et des érythrocytes non parasités forment des rosettes autour des globules parasités. Tous ces érythrocytes tassés, réduisent le flux sanguin et provoquent des dérangements métaboliques, qui finalement mènent à une insuffisance fonctionnelle profonde de l'organe non suffisamment irrigué. La réaction immunitaire envers les antigènes superficiels des stades sexués est limitée, pour des raisons similaires à celles qui jouent dans les stades asexués. Les structures internes des gamétocytes, par contre, ont maintenu une immunogénicité importante, mais ne sont normalement pas exposées au système immunitaire humain. Basées sur ces données fondamentales, de nouvelles directions dans le traitement du paludisme compliqué et les perspectives d'une vaccination sont discutées.