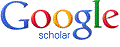Principes et règles d'utilisation des dérivés nitrés.
Auteurs : Garcia Moll M1Avec une utilisation longue de plus d'un siècle, les nitrates se posent comme le deuxième médicament le plus ancien (après les digitaliques) dans l'arsenal pharmacologique en cardiologie. Cela n'empêche pas qu'un certain nombre de facettes de leur mode d'emploi restent toujours contesté. Leur action vasodilatatrice, artériodilatatrice (au niveau coronarien notamment) et inhibitrice de l'agrégation des plaquettes en fait des médicaments utiles en particulier dans toutes les formes cliniques de la cardiopathie ischémique (angine stable ou instable et infarctus aigu du myocarde), à titre de traitement préventif ou curatif des crises ischémiques (silencieuses ou non); et aussi dans l'insuffisance cardiaque, où les nitrates sont utiles non seulement à titre de traitement symptomatique (associé ou non aux diurétiques), mais également de par leur effet positif sur la survie (associé dans ce cas à l'hydralazine : essai V-Heft I). A l'heure actuelle, les nitrates peuvent être administrés par les voies sublinguale, orale, intraveineuse ou transdermique sous forme de nitroglycérine et de dinitrate ou de mononitrate d'isosobide (en présentation à action courte à effet soutenu). Leurs contre-indications, rares, concernent des patients atteints d'une hypotension sévère (< 70 mmHg), d'une anémie sévère, d'un glaucome ou d'une hypertension intracrânienne. Les effets indésirables les plus importants sont les céphalées pulsatives (qui disparaissent habituellement au bout de quelques jours), l'hypotension orthostatique (pouvant aboutir à la syncope), la rubéfaction faciale, les vertiges, les palpitations ou les nausées et les vomissements. La plupart de ces effets indésirables peuvent être contrôlés par une adaptation des médicaments et il est rarement nécessaire d'arrêter l'administration. Cependant, le problème le plus important que pose l'utilisation des nitrates réside dans le développement d'une tolérance. Ce phénomène multifactoriel répond à une physiopathologie non encore bien connue. On a postulé le rôle de protagoniste que pourrait jouer la déperdition de groupes SH ou la mise en marche de mécanismes de rétrocontrôle humoral, avec augmentation du taux des catécholamines circulantes, activation du système R-A-A et augmentation du volume plasmatique. Cette complication peut être évitée par la mise en oeuvre d'un traitement intermittent, selon un intervalle libre de médicaments de 10-12 heures par jour. Par la voie orale, on utilise soit une seule dose d'une préparation à libération prolongée (60 mg de DNIS ou 40-60 mg de 5-MNIS), soit 2 ou 3 doses d'une préparation à durée d'action courte (20-40 mg de 5-MNIS). Par la voie transdermique, il faut envisager de laisser le patch en place pendant 12 heures. Il est conseillé de commencer par des doses faibles, augmentées progressivement par la suite. La période libre est habituellement la période nocturne, qui sera couverte le cas échéant par d'autres médicaments anti-ischémiques (par exemple les bêtabloquants et/ou les antagonistes du calcium), déjà utilisés habituellement en association avec les nitrates. Cette interruption ne s'accompagne pas d'un phénomène de rebond. Il ne faut pas oublier que les nitrates potentialisent l'action d'autres vasodilatateurs et des antagonistes du calcium et que chez certains patients, la nitroglycérine administrée par la voie intraveineuse réduit l'effet anticoagulant de l'héparine, alors que l'indométacine peut par contre inhiber leur effet vasodilatateur. Les nitrates jouissent donc d'une bonne santé en dépit de leur grand âge et, utilisés correctement, ils continuent d'être très utiles dans le traitement pharmacologique des affections cardiovasculaires.