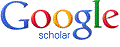Monoxyde d'azote (NO) et homéostasie circulatoire.
Auteurs : Arnal JF1En 1980, Furchgott et Zawadski démontrent que la relaxation des cellules musculaires lisses artérielles en réponse à l'acétylcholine est dépendante de l'intégrité anatomique de l'endothélium. Ils baptisent le principe à l'origine de cette relation intercellulaire EDRF (Endothelium Derived Relaxing Factor). L'EDRF fut 7 ans plus tard identifié comme étant un radical libre gazeux: le monoxyde d'azote (NO). De nombreuses substances comme la bradykinine, l'histamine, la sérotonine, l'acétylcholine et l'ATP exercent leur effet vasodilatateur en stimulant la production endothéliale de NO. Cependant, on considère actuellement que le plus puissant stimulus de la production de NO par l'endothélium est constitué par les forces de frottement (cisaillement) du sang sur l'endothélium. La vasodilatation produite en réponse à l'augmentation de débit (vasodilatation débit-dépendante ou encore flux-dépendante) s'ajoute ainsi à la vasodilatation locale d'origine métabolique. On peut ainsi considérer que le NO est un « dérivé nitré endogène généré localement par l'endothélium et ayant une action essentiellement paracrine (relaxation des cellules musculaires lisses sous-jacentes, mais aussi l'inhibition de l'agrégation plaquettaire). De nombreuses études cliniques ont montré l'existence d'anomalies de la vasodilatation endothélium-dépendante dans l'athérosclérose. Tandis que l'acétylcholine perfusée dans une artère coronaire saine entraîne une vasodilatation, elle provoque en revanche une vasoconstriction dans une coronaire ayant des lésions d'athérosclérose. Tandis qu'une diminution de la génération de NO et/ou de son activité pourrait être un élément important de la physiologie de l'athérosclérose, un excès de production de NO est en grande partie responsable de l'hypotension du choc septique.