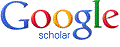Traitement du cancer de la prostate métastatique: certitudes et doutes.
Auteurs : Fournier G1, Valéri A■ Une mortalité élevée: En dépit des progrès réalisés dans le sens d'un diagnostic plus précoce, principalement grâce au dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA), le cancer de la prostate métastasé reste une question d'actualité puisque la mortalité par cancer de la prostate dépassait 40.000 décès en 1996 aux Etats-Unis. Plus de 50 ans après la découverte de l'hormonosensibilité du cancer de la prostate, le sevrage androgénique reste la pierre angulaire du traitement à ce stade. Ce traitement est palliatif mais permet de retarder la progression de la maladie pendant plusieurs années avant la survenue de l'échappement hormonal qui reste inévitable. ■ En cas de métastases ganglionnaires microscopiques (stades D1): L'attitude classique est l'hormonothérapie précoce ou différée avec une survie variable de 77 à 85% à 5 ans. Certaines équipes ont proposé d'associer un traitement radical (prostatectomie radicale ou irradiation pelvi-prostatique) au traitement hormonal, essentiellement dans le but d'un meilleur contrôle local de l'affection, mais il n'existe aucune preuve d'un gain en terme de survie. Métastases à distance (Stade D2): La castration médicale ou chirurgicale reste le traitement de e référence (associée parfois à des traitements spécifiques en cas de complications urinaires, neurologiques ou osseuses) et procure aux patients une médiane de durée de survie d'environ 3 ans. ■ Chez les patients asymptomatiques: persiste une controverse sur la date de début du traitement, immédiatement au diagnostic ou différé lors de l'apparition des symptômes. Bien que la tendance soit à la précocité du traitement, l'intérêt d'une telle attitude n'a pas encore été prouvé de façon incontestable en terme de gain sur la survie et de préservation de la qualité de vie. ■ Lors de l'échappement hormonal (stade D3): La survie est en moyenne inférieure à un an. La castration doit être maintenue et les antiandrogènes, si ils avaient été prescrits initialement en combinaison avec la castration (blocage androgénique complet) doivent être interrompus (syndrome de retrait des antiandrogènes) avant de juger de la nécessité de recourir aux traitements de seconde intention, hormonaux ou non. Ces derniers n'ont le plus souvent qu'un effet transitoire et symptomatique et leur indication doit prendre en compte leurs effets secondaires parfois néfastes sur la qualité de survie. Les traitements symptomatiques ont une place prépondérante à ce stade combinant le traitement des douleurs osseuses (antalgiques, radiothérapie externe ou métabolique), des complications neurologiques ou urologiques (résection transuré- | trale et/ou dénvations urinaires) et la prise en charge psychologique grâce à une approche multidisciplinaire associant radiothérapeute, oncologue, urologue et médecin généraliste.