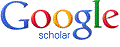IntroductionMycoplasma genitalium(MG) apparaît aujourd’hui comme un pathogène émergent dont la détection est devenue indispensable. Les dernières données de prévalence le placent souvent en deuxième position des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes derrièreChlamydia trachomatis. Il serait notamment responsable de 10 à 35 % des urétrites non gonococciques chez l’homme. En France, la pathologie reste encore mal connue et le diagnostic est souvent tardif. Notre étude vise à évaluer le taux de positivité dans la population testée dans notre centre de santé et la symptomatologie associée aux différents cas diagnostiqués.Matériels et méthodesEntre août 2016 et janvier 2018, un total de 1045 prélèvements a été testé. Ces prélèvements étaient issus de patients se présentant dans notre centre pour une consultation de médecine générale ou spécialisée (infectiologie, urologie) ou pour une prise en charge au CeGIDD. Les tests ont été réalisés en routine, sur le même tube que celui destiné à la recherche deChlamydia trachomatis(CT) etNeisseria gonorrhoeae(NG), avec le kit AptimaMycoplasma genitaliumAssay (marquage CE) sur notre automate Panther (Hologic®).RésultatsLa majorité des recherches a concerné des examens du premier jet d’urine (82,3 %), mais aussi des prélèvements vaginaux (14,4 %), des prélèvements anaux/rectaux (1,3 %), des spermes (1,1 %) et des prélèvements divers (1 %). Le taux de positivité global était de 6,5 % et lorsque les recherches de CT et NG étaient associées, le taux de positivité de MG était supérieur à ceux de CT et NG (5,4 % vs 2,4 % et 1,8 % respectivement). L’expression clinique de la pathologie était très variable, allant de l’absence totale de symptômes à une symptomatologie bruyante (brûlures mictionnelles, prurit, écoulement purulent, etc.). Par ailleurs, nous avons identifié une souche multirésistante dont l’éradication a nécessité plusieurs cures d’antibiotiques.ConclusionLe fort taux de positivité retrouvé pose la question de la prévalence de MG dans les populations à risques et donc de l’intérêt d’un dépistage systématique chez ces patients. La recherche de MG est indispensable chez les patients présentant une urétrite, à minima en seconde intention, afin d’éviter les complications (chronicité, prostatites). Une recherche systématique de première intention permettrait en outre de limiter l’émergence de souches résistantes, en partie liée aux traitements probabilistes inadaptés. L’accès aux outils de diagnostic et de recherche des gènes de résistance est encore limitée, mais il est important de prendre conscience de l’implication de ce pathogène dans les infections uro-génitales afin d’améliorer la prise en charge des patients.