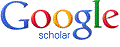La découverte d’une neutropénie est une circonstance relativement fréquente en pédiatrie. La très grande majorité des neutropénies sont transitoires, le plus souvent secondaires à une infection virale ou bactérienne, ou encore liées à la prématurité, et exceptionnellement inaugurales d’une hémopathie maligne. La neutropénie peut également être chronique, persistant au-delà de 3 mois, et peut faire discuter plusieurs étiologies comme la neutropénie dite « ethnique », la neutropénie auto-immune, et les neutropénies génétiques. Parmi les neutropénies chroniques, la neutropénie auto-immune primitive constitue une cause fréquente. Son évolution est habituellement marquée par une bonne tolérance et une récupération dans un délai de 12 à 36 mois. Les neutropénies « congénitales » sont une famille de pathologies monogéniques, très rares (environ 20 nouveaux cas/an en France) et très diverses (environ 30 sous-types différents). On les évoque devant une présentation clinique sévère, des pathologies d’autres organes associés ou d’une neutropénie profonde et persistante sans signe d’auto-immunité. Les enfants atteints de neutropénies génétiques sont exposés à des infections bactériennes majeures et à des infections buccodentaires. Ils présentent un risque leucémique et souvent des anomalies de plusieurs organes en plus de l’atteinte hématologique. La prévention des infections chez les enfants atteints de neutropénie chronique repose d’abord sur une évaluation individuelle de chaque enfant concerné. Elle peut faire appel à l’antibiothérapie prophylactique qui repose avant tout sur l’association sulfaméthoxazole-triméthoprime quotidienne, et d’autre part, sur les facteurs de croissance hématopoïétique, principalement legranulocyte-colony stimulating factor(G-CSF).