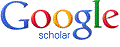Neurologie des émotions : un panorama des preuves expérimentales et cliniques
Auteurs : HABIB M1Sous le terme d'émotion, on englobe habituellement les phénomènes physiques et mentaux accompagnant la perception, l'expression et l'expérience des affects, de même que les modifications somatiques qui les accompagnent. Les mécanismes sous-jacents aux émotions sont volontiers décrits actuellement, par référence aux données expérimentales chez l'animal, par la notion de renforcement, conçue comme la capacité d'un stimulus à augmenter ou réduire la probabilité d'observer un comportement donné. Un certain nombre d'observations expérimentales et cliniques ont ainsi éclairé le rôle de certaines structures cérébrales, répondant au concept de système limbique, concept qui reste opérationnel malgré une imprécision anatomique de plus en plus souvent soulignée. L'élément central de ce système est le noyau amygdalien, dont le rôle spécifique serait de réaliser l'association entre stimulus et renforcement. Les lésions de ce noyau provoquent, chez l'homme comme chez l'animal, des troubles comportementaux profonds (syndrome de Klüver-Bucy), associant une hyporéactivité émotionnelle, une apathie et une docilité excessive, habituellement considérées comme des manifestations d'une déconnexion visuo-limbique. A côté de l'effet de lésions sous-corticales, celui de lésions touchant les portions dites paralimbiques du cortex cérébral a été également étudié. Les lésions cingulaires sont la cause bien connue du syndrome de mutisme akinétique, en particulier quand le cortex adjacent de l'aire motrice supplémentaire est également touché. Les lésions insulaires ont été rendues responsables de perturbations des aspects attentionnels de la communication verbale et non verbale, suggérant le rôle de cette région dans les prérequis attentionnels des relations interpersonnelles. Les lésions orbito-frontales sont connues pour provoquer une incapacité à gérer les situations reposant sur l'interaction sociale, réalisant une cosiopathie acquise. Un modèle récent propose que des marqueurs somatiques, représentant la composante viscérale des expériences socio-affectives, sont produits pendant la maturation de l'individu par confrontation entre le contexte social et ses conséquences affectives. La survenue ultérieure du même contexte évoquerait des souvenirs somatiques inconscients qui seraient stockés dans le cortex orbito-frontal et rendus indisponibles par l'effet de lésions pathologiques de cette région.