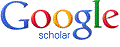Facteurs métaboliques associés à l'obésité abdominale impliqués dans l'athérothrombose
Auteurs : HANSEL B1, BRUCKERT E1L'obésité abdominale est considérée comme un facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires. Les mécanismes expliquant le rôle l'excès de graisse abdominale dans le développement de l'athérothrombose ont été largement étudiés ces dernières années. La toxicité du tissu adipeux viscéral, par le biais des multiples sécrétions dont il est responsable est au premier plan. Des perturbations profondes du métabolisme des lipoprotéines conduisant à la formation de particules riches en apoprotéine B très athérogènes et de particules HDL dysfonctionnelles sont également en cause. Les anomalies du métabolisme glucidique, avant même que n'apparaisse un authentique diabète, interviennent certainement par le biais de l'insulinorésistance et de l'hyperinsulinisme. Le rôle direct de l'hyperglycémie est plus débattu. D'autres perturbations telles que les anomalies du métabolisme de l'acide urique et du métabolisme hépatique semblent aussi en cause. Au delà de ces considérations physiopathologiques, l'enjeu est aujourd'hui de déterminer les marqueurs mesurables en routine les plus utiles pour évaluer le risque résiduel des patients ayant une obésité abdominale. Le LDL-cholestérol est un paramètre essentiel mais d'autres mesures telles que celle des apoprotéines et en particulier de l'apoprotéine B et du cholestérol non-HDL devraient être intégrées dans l'évaluation du risque. D'autres mesures très prometteuses sont pour le moment réservées à des travaux de recherche. Il s'agit des données qualitatives concernant les lipoprotéines, évaluant l'athérogénicité des LDL et des autres lipoprotéines ainsi que l'étude de la composition et de la fonctionnalité (pouvoir antiathérogène) des HDL.